Entretien avec Denis Marleau et Stéphanie Jasmin

Avec Le vieux monde derrière nous, Denis Marleau et Stéphanie Jasmin poursuivent leur exploration du lien entre théâtre, image et mémoire. Après avoir présenté Chronologies la saison précédente au CTD’A, ils reviennent avec une nouvelle création où l’intime rejoint la grande Histoire. Entretien croisé avec deux artistes dont les plus récentes œuvres font du théâtre un espace de rencontre entre les générations et avec les figures absentes.
Comment est née votre envie de porter ce texte à la scène ?
Denis Marleau : J’ai lu le livre d’une seule traite en une soirée, c’était en mars 2022. Le lendemain j’envoyais à Olivier la photo d’un scooter prise dans notre entrepôt, celui des Femmes savantes, pour lui dire que j’aimerais créer un spectacle à partir de son récit.
— J’ai vraiment hâte qu’on se parle de ce projet. Plus cette guerre [en Ukraine] se prolonge à notre grande sidération, plus cet échange entre un fils et un père, entre tous les temps de leur histoire, commune et distincte, m’apparaît essentiel et nécessaire à faire entendre en ce moment. Amitié. Denis
— Avec grand plaisir mon cher ! il est vrai que le point de bascule de l’Europe en 68, où un nouveau monde se mettait en branle, semble se répéter, mais en un sens inversé : alors que les dictatures agonisaient (Franco, Salazar, Tito, les colonels en Grèce), celles-ci reviennent en force : Orban en Hongrie, Poutine bien sûr… Olivier
Après avoir rencontré Sylvain Bélanger au Théâtre d’Aujourd’hui, j’envoyais un texto à Mani pour lui proposer le rôle.
— Je l’ai écrit à Olivier : Le vieux monde derrière nous m’a littéralement secoué de rires et de larmes du début à la fin. (Je suis bien plus sensible qu’il n’y paraît…) 😉 Je m’y suis retrouvé un peu, moi-même étudiant à Paris au milieu des années 70, dans une Europe que je découvrais. Ce « vieux monde » évoqué avec tant de justesse et de truculence s’est donc retrouvé derrière moi aussi, de façon plus intime, dans ma relation à mon propre père, né à Verdun au bord du Saint-Laurent, tout près des îles d’Expo 67 qui l’ont vu « renaître » à l’âge de quarante ans. À partir de là, mon papa est parti à la recherche de l’histoire, celle avec un grand H qu’il avait apprise dans les livres, pour sillonner l’Europe pendant plus de trente ans.
En refermant le livre, je me suis dit que ce récit pourrait bien se transposer sur une scène où un fils d’aujourd’hui, dans la quarantaine, se mettrait à dialoguer avec son jeune père, dans la vingtaine… peut-être aussi avec son grand-père, et sa blonde (la mienne s’appelait aussi Carole…). C’est donc cette impulsion de metteur en scène, que j’ai partagé d’abord avec Olivier et que je voulais te transmettre. Sait-on jamais, ça te parlera peut-être aussi ? Faut rien forcer, c’est juste du plaisir et après on verra.
Ce qui m’a d’abord frappé c’est l’art du récit d’Olivier, dense, érudit, digressif, parfois ironique, jouant à la fois plusieurs temps de l’histoire et dont l’écriture composée de longues phrases se déplie en contrepoint des cartes postales brèves, naïves et comiques, sentimentales et péremptoires de son père Gil. Dès la première lecture, j’ai entendu leurs voix distinctes dans cette inversion d’âge : un fils de 45 ans conversant avec son père de 22 ans. Si une telle rencontre fictionnelle est possible sur papier, je me suis dit qu’elle pouvait devenir, sur scène, une expérience de création qui libère autant d’émotions lyriques et d’affects que de pensées critiques.
La fin des années 60 — j’avais 14 ans en mai 68 — a aussi marqué mon imaginaire. Et plus tard, j’ai eu à ouvrir et à classer des enveloppes pleines de photos, de cartes postales, de correspondance et les dizaines de boîtes de diapositives que mon père a rapportées de ses voyages. J’ai même retrouvé les passeports d’Expo 67 que j’ai visitée avec mes parents. Autre réminiscence, j’entends encore mon père bouleversé me racontant que le 21 août 1968 il était à la Casa Pedro à Montréal et qu’il échangeait avec son voisin de table, le journaliste Pierre Nadeau, choqué et abasourdi par la nouvelle qui venait de tomber : l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’armée soviétique. Tous ces souvenirs m’ont mis au travail, dans cette impulsion d’amener au théâtre Le vieux monde derrière nous.
L’idée de confier à Mani Soleymanlou à la fois le rôle du jeune père et celui du fils s’est-elle imposée dès le départ ?
Denis Marleau : C’est Olivier qui a d’abord soufflé le nom de Mani, que j’ai reçu comme une évidence. Qui d’autre peut être à même de jouer un fils d’immigré de la première génération et son père venu du Moyen Orient ? Après avoir lu le livre, Mani m’a spontanément parlé de son propre rapport au père. Il avait envie de relever le défi de jouer en solo une écriture autre que la sienne. Notre chance avec lui, c’est qu’il est rompu à ce genre d’exercice, c’est un performeur de grande expérience autant à la télé, au cinéma que sur une scène de théâtre. Il m’impressionne tant par sa créativité, sa force de proposition, que par sa capacité stimulante à se mettre très vite en état de recherche de justesse, de vérité.
Il fallait donc que j’embraye au plus tôt sur l’adaptation du récit. Pour cela, j’ai dû aussi faire des choix, opérer des coupes dans ces longs paragraphes et digressions virtuoses dont certains chemins ne peuvent s’emprunter que par la lecture. J’ai parfois joué avec les faux dialogues esquissés par Olivier, j’ai créé quelques ellipses. Mais je n’ai rien ajouté ni réécrit, les mots de Gil sont ceux des cartes et lettres retranscrites dans le récit d’Olivier. À l’exception d’un prologue tiré d’une entrevue que l’auteur a fait à France Inter et d’un épilogue dont je réserve la surprise…
Comment votre dialogue artistique s’est-il déployé dans la création de ce spectacle, et de quelle manière vos démarches respectives se sont-elles nourries l’une l’autre pour en façonner la forme finale ?
Stéphanie Jasmin : À partir du moment où Denis a manifesté son désir d’adapter et de monter ce texte, nous avons commencé à imaginer ensemble la forme scénique qu’il pourrait prendre. Nous avons tout de suite perçu l’importance des cartes postales au sein du récit d’Olivier. Ce sont elles qui apportent les mots réels du père et conséquemment les élaborations historiques, intimes ou hypothétiques du fils comme tentative de saisir et comprendre plus profondément le jeune homme que Gil était avant sa naissance. Ce sont aussi ces cartes qui rythment le récit et déploient le voyage de Gil dans tous les pays qu’il a traversés. Très tôt j’ai proposé que Gil puisse vivre dans ses cartes et y prendre la parole. Que la carte postale s’anime à la lecture d’Olivier sur le plateau et qu’il imagine son père dans les lieux d’où il écrit, qu’il entende sa voix. La présence de ces cartes « images » est alors devenue l’endroit possible de « projection » du personnage de Gil, jouant aussi cette présence différée entre le père et le fils. En ce sens, comme dans la plupart de nos collaborations, l’intuition puis l’idée d’une première forme devient une structure pour penser le spectacle ensuite, lui donner un espace poétique, un fonctionnement. Ainsi, la place de Gil se situe dans les images qu’il a envoyées et dans les lieux d’où il écrit à Carolle son amoureuse ; celle d’Olivier se trouve sur le plateau, établissant la relation scénique entre les deux personnages.
À la recherche de ces cartes postales, j’ai décidé de partir en Europe avec ma caméra pour les filmer au plus près possible de leur point de vue et un petit enregistreur Zoom pour glaner les sons. J’ai donc effectué une bonne partie du voyage de Gil, celle que Denis a délimitée dans son adaptation, passant rapidement d’une ville à l’autre, d’un pays à l’autre, pour filmer ces cartes, mais aussi des déplacements et des lieux correspondant à ce que Gil raconte et à ses états d’âmes. J’avais toujours en tête de cadrer la place du voyageur dans ces images, d’imaginer Gil qui viendrait s’y insérer par la magie de l’écran vert. Le résultat devient ce personnage, qui s’anime en son et image dans la tête d’Olivier.
Denis Marleau : Toutes ces images tournées en 2025 par Stéphanie à partir des cartes postales de Gil qui datent des années 60 sont forcément truffées d’anachronismes. Mais ce sont des anachronismes assumés et qu’on pourrait dire « volontaires » de la part du personnage d’Olivier qui projette son père dans des lieux ou des sites qu’il a peut-être visités ou qu’il imagine aujourd’hui. Ce dispositif, avec son écran « mental » et sa table d’écrivain, devient ainsi par extension une sorte de cinéma familial qui joue avec une de mes obsessions personnelles, le fantôme.
Le récit d’Olivier Kemeid s’ancre dans le réel tout en gardant une grande charge poétique. Comment avez-vous choisi de traduire cette dimension documentaire sur scène ?
Denis Marleau : Ce n’est pas du théâtre documentaire, mais c’est un récit qui parle au je, celui d’Olivier Kemeid qui écrit sur son père Gil et qui reprend les mots réels de celui-ci, envoyés à sa fiancée tout au long de son périple. J’ai choisi d’assumer et même de marquer dès le prologue cette relation à la réalité de sa démarche. Mani joue donc Olivier sur le plateau et son père Gil dans les images. Ce que je souhaitais, c’était camper le personnage d’Olivier dans son atelier, son lieu de travail, de recherche et d’écriture. S’agit-il des tables de l’architecte qu’était son père ? Peut-être… En tout cas c’est le lieu où sont rangés ses artefacts, avec quelques souvenirs de familles, classés et observés par Olivier. Les tables deviennent le territoire du « voyage » du fils, le voyage de l’écriture, à l’instar du continent européen qui est le terrain de son père. Ainsi Stéphane Longpré a conçu dans un esprit minimaliste la présence de ces tables dans un espace vide, puis avec l’accessoiriste Clara Pinto il a encombré leur surface d’objets, de traces des recherches d’Olivier, ainsi que des authentiques cartes postales, cartes géographiques et maquettes d’architecture de Gil.
Stéphanie Jasmin : Ce territoire de création d’Olivier, en friche, sera visible à l’écran, en contrepoint, pour donner accès en direct aux artefacts de son travail d’écriture qu’il manipule sur scène. C’est la deuxième trame vidéo qui vient structurer et ponctuer le spectacle. Olivier est présent, nous le voyons incarné face à nous avec son regard, son visage, mais je voulais montrer en gros plan ses mains et du même coup les traces de celles de Gil, qui a écrit les lettres et cartes postales que son fils manipule.
Stéphanie a signé la mise en scène de Chronologies, tandis que Denis signe celle du Vieux monde derrière nous, deux créations d’UBU présentées au CTD’A à un an d’intervalle. Quels parallèles ou contrepoints voyez-vous entre elles ?
Stéphanie Jasmin : Elles sont devenues de façon impromptue une sorte de diptyque à maints égards. D’emblée les deux abordent la transmission : mère / fille dans Chronologies et père / fils dans Le vieux monde derrière nous. Elles mettent en scène un·e auteur·rice qui tente, par l’écriture, de « boucher les trous » d’une histoire familiale ; l’une pour briser le silence du trauma, l’autre pour imaginer le jeune homme qu’était son père et ce qui n’est pas dit dans ses cartes postales. Les deux pièces évoquent les conséquences de la grande Histoire sur les histoire intimes, bousculées par l’exil ou la migration. Enfin, il y a au centre de chacune le désir d’un retour aux sources, au pays natal. Deux voyages s’accomplissent durant ces pièces : celui de l’Autrice incarnée par Stephie Mazunya en Afrique dans Chronologies et celui de Gil, réimaginé par son fils, qui sillonne l’Europe mais ne se rendra pas au bout de sa quête…
Sur le plan scénique, la vidéo transmet l’expérience de ces voyages de façon plus introspective dans Chronologies et plus ludique dans Le vieux monde derrière nous, où elle se déploie au gré des cartes postales dans une esthétique proche de la bande dessinée. Dans les deux cas, le tournage a représenté une expérience marquante pour moi. Il s’agissait de filmer le regard réel de Stephie Mazunya sur le Burundi, son pays, et sur le Rwanda voisin. Puis de marcher dans les pas de Gil dans cette grande traversée du Vieux monde derrière nous en l’imaginant « incrusté » plus tard dans le paysage lors d’un tournage sur écran vert.
Quelle place occupent le dialogue et la rencontre dans Le vieux monde derrière nous ?
Stéphanie Jasmin : Olivier est seul, avec comme artefacts les mots que son père a écrits à 22 ans lors de son voyage. Il ne peut qu’envisager un dialogue imaginaire et différé avec lui, un dialogue qui s’avère impossible car Gil ne s’adresse pas à son fils (qui n’est pas encore né!) mais à son amoureuse Carolle (qui deviendra la mère d’Olivier). Ce qui prend place pourtant, dans une grande intimité, c’est la tentative d’Olivier d’entrer dans la tête de Gil, d’imaginer ses sensations, ses pensées derrière les mots, au-delà des mots. Et sa façon de réagir à ses commentaires, ses jugements intempestifs, sa mauvaise foi, son lyrisme, ses blagues, sa mélancolie. Cela ouvre un endroit bien particulier, celui d’une relation a posteriori, où la tendresse, la critique, l’étonnement, l’amour émergent malgré l’absence.
Comment l’humour se manifeste-t-il dans ce spectacle ?
Denis Marleau : L’humour revient sous plusieurs formes dans les spectacles d’UBU… avec des auteurs aussi différents que ceux de l’Oulipo, Queneau, Dubillard, ou Schwitters, Jarry, Tzara, Molière, Beckett, Chaurette et Bernhard. Il se module sur divers registres : impromptu, impertinent, sarcastique, jaune, noir, doux, désespéré, jubilatoire… Dans Le vieux monde derrière nous, il revêt des accents comiques plus près de la bande dessinée ; un humour tendre et naïf, parfois risible, avec quelques jeux de mots un peu potaches. L’exagération du trait de caractère, une certaine façon d’extraire de notre mémoire les travers d’un être cher. Mais cet humour prend surtout appui sur les textes de Gil et ceux d’Olivier : les deux partagent cet art de « théâtraliser » une situation, de créer des liens inattendus entre les choses, d’écrire des chutes bien senties. Il est tout de même surprenant de lire, dans les lettres de Gil, de véritables saynètes, comme ces dialogues à Istanbul avec un préposé de la gare ou le responsable de l’ambassade syrienne.
À quel point la création est-elle, pour vous, un voyage – au sens propre comme au figuré ?
Denis Marleau : Je ne conçois pas autrement ma pratique théâtrale que comme un processus qui nous déplace, nous fait voyager. Voyager dans le temps, à travers plusieurs époques à la fois. D’ailleurs les auteurs qui m’intéressent travaillent sur le temps. Dans ce récit d’Olivier, il y a quelques passages qui résonnent avec notre propre actualité politique, sociale, et certaines concordances historiques et géographiques se tissent de façon presque naturelle.
Stéphanie Jasmin : Parallèlement à ce voyage littéraire, j’ai réalisé un voyage réel dans plus d’une vingtaine de villes et près d’une dizaine de pays en très peu de temps, dans une folle quête des cartes postales de Gil, marchant sur ses pas et roulant derrière sa Vespa. Une course contre la montre, « qui court vite » comme dirait Gil. Je me surprenais à réagir comme lui parfois, à ressentir ses propres obsessions, telle celle de la météo qui conditionnait mes tournages… C’était une sorte d’utopie poétique, de jeu dans lequel la préparation et la planification s’équilibraient avec la coïncidence, la surprise et une forme de perte de contrôle ou d’improvisation. Et à l’instar de Gil, qui éprouvait par moments une sorte de décalage ou de solitude mélancolique, en plongeant dans ces lieux « de cartes postales » je me suis sentie souvent sidérée et profondément consternée par les méfaits du surtourisme qui brouille la poésie ainsi que la vie réelle des quartiers et de leurs habitants. Aussi, à part les quatre Québécoises que Gil croise à répétition, je l’ai souvent cadré seul ou isolé dans ces paysages que je traquais à des heures où le touriste n’est pas encore trop présent. Ailleurs, je l’ai fait apparaître seul dans la foule, comme s’il était perdu, littéralement hors de son temps.
Comment s’est élaborée l’intégration de la trame filmique en répétition et dans la représentation ?
Denis Marleau : Avec Mani, on a convenu qu’il fallait faire exister Gil avant d’amorcer la trame d’Olivier. C’est donc le jeune homme de 22 ans que nous avons répété pendant un mois afin de lui trouver une voix, un accent, définir une silhouette, une tête, pour ensuite tourner le personnage sur écran vert en précisant chaque plan, chaque position et action selon les prises de vue filmées par Stéphanie. Après, c’est le personnage d’Olivier que nous avons intégré, l’auteur dans son atelier qui élabore en direct sur scène son récit de voyage.
Stéphanie Jasmin : En fait, à la différence du cinéma où tout est scellé à la fin, c’est-à-dire que la durée de chaque plan est fermée et définitive dans le montage final, ici l’image doit demeurer souple. Il y a un acteur vivant sur le plateau qui doit jouer dans le temps présent et ne peut être obligé de s’insérer entre les répliques de l’autre personnage dans le film. Le rythme du jeu sur scène fluctue d’un soir à l’autre, c’est la nature même de l’art vivant qu’est le théâtre. Or, un décalage de deux ou trois secondes pourrait enrayer la continuité entre la scène et l’écran, causant par exemple une superposition des répliques des deux personnages. La représentation nécessite une souplesse qui nous oblige à créer des « cues » pour chacune des répliques parlées à l’intérieur du même plan filmé, au risque d’en briser un peu la fluidité. C’est du cinéma « vivant » en quelque sorte, qui doit respirer soir après soir avec l’acteur sur le plateau, et non l’inverse. Ainsi s’élabore une sorte d’approche cinématographique artisanale qui s’adapte aux modalités et contraintes du théâtre et met de côté sa « pureté » formelle pour en accepter « l’imperfection ». Au point de vue sonore aussi la conception doit tenir compte de la mécanique du théâtre et de l’équilibre entre la scène et l’écran. François Thibault au design sonore et Jérôme Minière à la composition musicale ont choisi de créer des gros plans sonores, des phrases musicales, des ponctuations liées non seulement à l’image mais aussi aux réactions et aux interactions avec le personnage d’Olivier sur scène… Le travail de montage de mon collaborateur de longue date Pierre Laniel pour incruster le personnage là où je l’avais imaginé en tournant les paysages a été extrêmement précieux. Marc Parent aux lumières a cherché aussi à se rapprocher de la lumière de chaque lieu pour intégrer le personnage lors du tournage sur écran vert. Je précise finalement que, si j’étais seule pour le tournage des images-paysages, j’ai pu compter pour le tournage en studio du personnage sur écran vert sur une petite équipe extraordinaire, qui ne venait pas du cinéma mais réunissait tous les concepteurs du spectacle, au son, aux régies, au maquillage et aux costumes. Disposant d’une semaine pour tourner plus d’une centaine de plans avec Mani dirigé par Denis, nous avons tous cherché et travaillé dans le but commun de parvenir à intégrer ces images dans la conduite et le fonctionnement de la représentation théâtrale.
En lien avec le spectacle
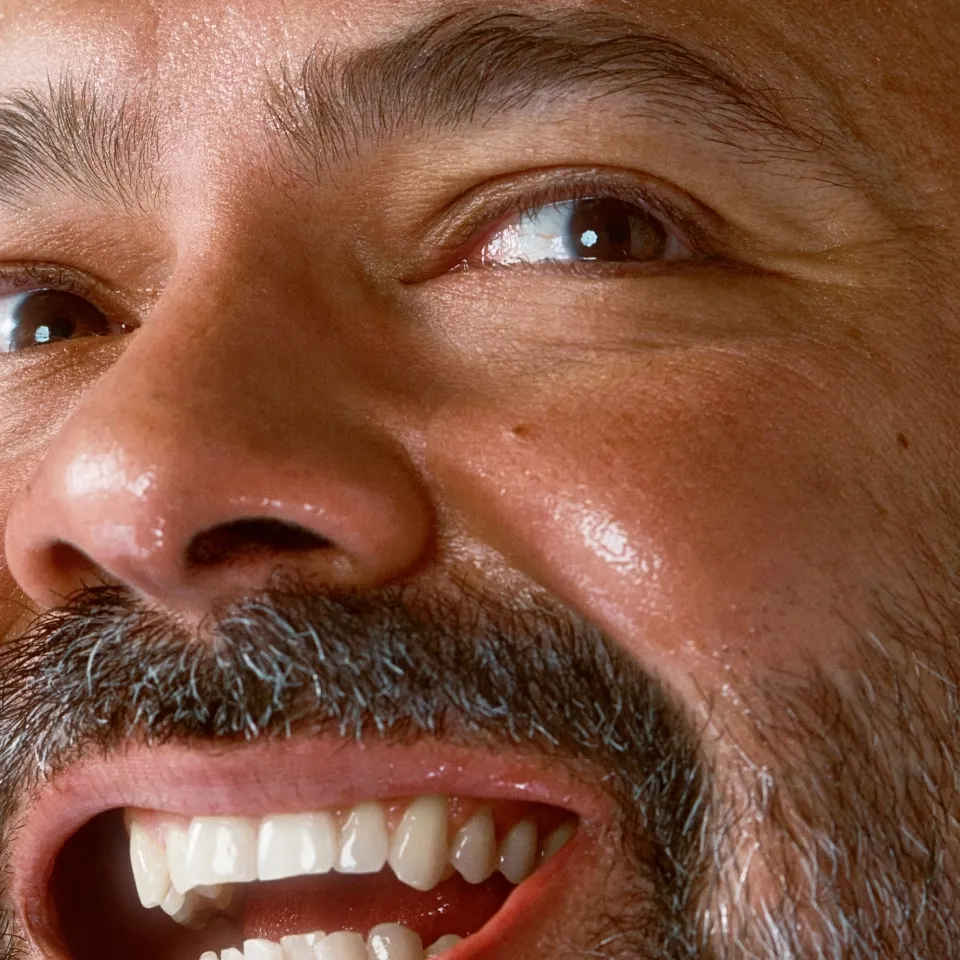
Le vieux monde derrière nous
Olivier Kemeid
Salle Michelle-Rossignol
11 novembre au 6 décembre 2025
En lien avec les artistes

Abonnez-vous !
Choisissez au moins trois spectacles parmi les douze qui composent notre saison 2025 – 2026 et bénéficiez d’un rabais progressif sur le prix de vos billets, en plus de nombreux privilèges exclusifs : changements de dates sans frais, concours mensuels, réductions chez nos partenaires culturels et plus encore !

